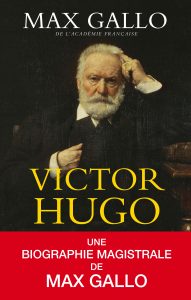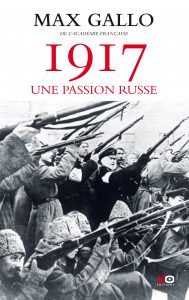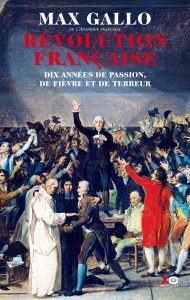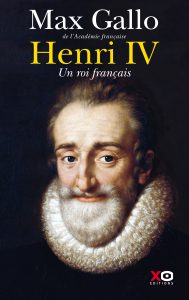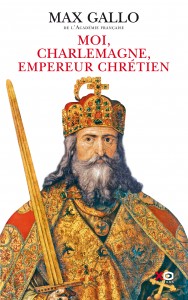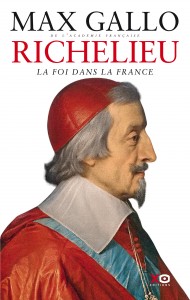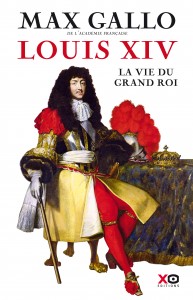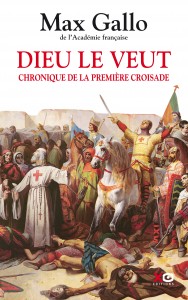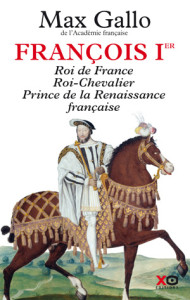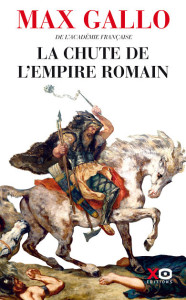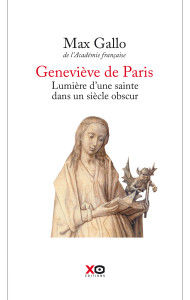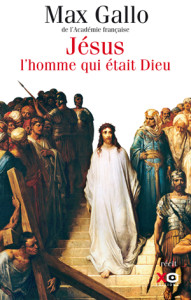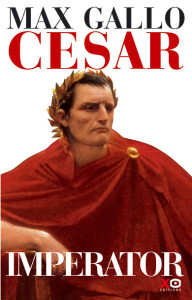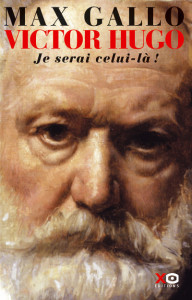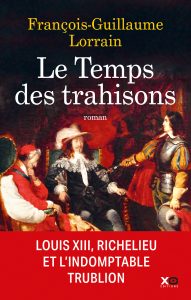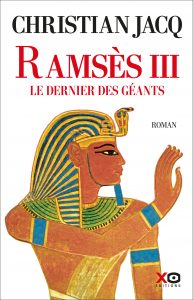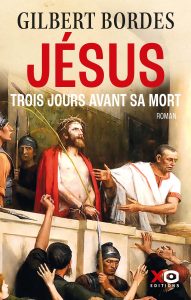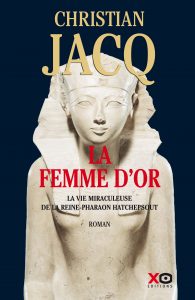Bleu Blanc Rouge comptera trois volumes, dont le dernier se termine fin 1999. Le premier tome, Mariella, commence en 1792 en pleine Révolution. Pourquoi justement cette période ?
M. G. : Je crois qu’il y a un cycle de l’Histoire de France qui se termine, et pas seulement pour des questions de chronologie. Ce cycle commence avec la Révolution française et s’achève en effet à la fin du XXe siècle, quand le mot même de « révolution » a épuisé toute sa réalité historique et même son imaginaire. Aujourd’hui, quand on parle de 89, on n’oublie pas la Terreur ou la Vendée. La Révolution n’est plus envisagée comme elle l’était encore à la fin du XIXe siècle quand Clemenceau disait : « La Révolution est un bloc. » C’est en ayant conscience de ce cycle, qui a duré deux cents ans, que j’ai choisi de commencer en 1789-1792, et de conduire ce roman jusqu’à la fin de notre siècle.
Six familles donc dans cette trilogie, et de milieux très divers, dont les destins se croisent sur plusieurs générations…
M. G. : Deux cents ans, cela peut paraître très long, et c’est en fait extrêmement court ! J’ai dans ma bibliothèque le livre d’un historien d’origine polonaise, Romuald Szramkiewicz , qui a été sans doute le déclencheur de mon imaginaire. La Banque de France a été fondée en 1800 et cet ouvrage retrace la généalogie des familles qui ont occupé une position importante à partir de cette date. Grâce à des actes notariés, on découvre qu’il y a encore aujourd’hui des descendants de ces gens-là dans le monde bancaire. Ceci pour dire que l’on peut très bien suivre six familles sur deux siècles, que ce n’est pas seulement un artifice de romancier. Jean d’Ormesson, pour prendre un autre exemple, a pour ancêtre un Le Peletier de Saint-Fargeau qui a été poignardé parce qu’il avait voté la mort du Roi en 1793…
Mais je crois en revanche que, depuis une vingtaine d’années, il y a vraiment une rupture historique qui se dessine parce le rythme du temps change, parce que les souvenirs sont brusquement renvoyés très loin à cause des bouleversements technologiques, des médias, etc. C’est pourquoi j’ai voulu que ce roman commence, dans le prologue, par la présentation d’une série télévisée à la Comédie-Française… Pour bien montrer que nous sommes actuellement à un tournant de l’Histoire, et ce depuis une vingtaine d’années – car les changements ne sont jamais instantanés – à cause de la télévision, à cause de l’image, à cause de ce qu’on appellera la mondialisation mais surtout de l’accélération des choses. Ainsi le passé s’éloigne très vite alors qu’il avait été très proche encore jusqu’aux années 1960, 1970. Il m’a donc semblé urgent de saisir cette période qui va être repoussée à tout jamais dans nos mémoires, pour que l’on sache d’où l’on vient et qui nous sommes : c’est le projet de Bleu Blanc Rouge.
Dès le début du roman, les opinions s’affrontent. L’un des héros, Philippe de Taurignan, va le payer de sa vie…
M. G. : Philippe de Taurignan et sa lignée sont issus de la noblesse. J’ai voulu rappeler à travers eux ce que l’on oublie parfois, malgré les Mémoires d’outre-tombe ou d’autres récits de cette époque, que pour la noblesse d’abord, la Révolution n’a pas été qu’un événement politique mais bien la fin d’un monde, la fin d’un système de valeurs, d’habitudes de vie… On connaît le mot de Talleyrand disant que ceux qui n’ont pas connu l’Ancien Régime ne pourront jamais savoir ce qu’était la douceur de vivre ! D’une certaine façon, en effet, il y a tout un monde qui s’effrite, qui disparaît pour ceux qui en étaient l’âme, les aristocrates.
Un autre personnage, Maximilien Forestier, est lui, d’origine paysanne et a choisi l’armée…
M. G. : A côté du destin de Philippe de Taurignan, j’ai suivi dans le « grand fleuve » des vies aux rythmes et aux espoirs différents, celui d’un fils de paysans comme Maximilien Forestier, et ceux de gens modestes qui vont connaître, à cause de la Révolution, une ascension sociale inattendue. La Révolution va leur permettre d’accéder à la gloire et à l’argent. On pouvait en effet, en étant sergent en 1789 ou simple soldat de ligne – comme bien des biographies de maréchaux de l’Empire le montrent – devenir général ou maréchal d’Empire, et par la même occasion faire fortune, grâce non seulement aux émoluments versés, mais surtout à la rapine. Pensons par exemple à Masséna ! Toute cette période encourage la spéculation mais aussi les affaires, les enrichissements rapides. Il faut fournir à l’armée des armes, des vivres, des vêtements. Des banques, non seulement la Banque de France, se constituent dans ce but… D’où le jeu sur les monnaies, les trafics, etc. On achète des biens nationaux, ceux des nobles émigrés, de l’Eglise. On n’était rien, on devient châtelain, et bientôt noble d’Empire. C’est pour cela qu’un personnage comme Guillaume Dussert, simple clerc, va devenir un très puissant banquier.
Et puis il y a les femmes, qui ont d’autres problèmes à résoudre…
M. G. : Pour les femmes, c’est aussi une période où tout un monde s’effondre… Il y a des rencontres qui n’auraient pas pu se produire dans une société stable et qui ont lieu, brusquement, parce qu’un sergent devenu capitaine ou colonel se retrouve soudain introduit dans un salon parisien quand, après la chute de Robespierre, la vie mondaine reprend. C’est le cas de Maximilien Forestier, qui a tout à coup l’occasion de rencontrer la descendante d’une grande famille qui, elle, est désargentée parce que ses parents ont été guillotinés, ses bien vendus comme biens nationaux. Telle jeune femme est à la recherche d’une nouvelle position dans la société, et n’a d’autres solutions que d’épouser un banquier. Les mariages de ce genre sont légion à cette époque, parfois d’ailleurs simplement dictés – mais ce n’est pas le cas dans mon roman – par la nécessité de sauver sa tête !
Nous croisons aussi, entre autres, Bonaparte qui a un rôle important dans Mariella…
M. G. : L’avantage d’un roman dont le ressort est l’Histoire – et c’est bien sûr aussi pour moi le charme de cette aventure, c’est de permettre de faire se croiser les personnages de l’imaginaire avec les personnages historiques de premier plan. Bonaparte, qui est évidemment la grande figure de proue de ce début du XIXe siècle, est l’un des acteurs du livre, puisque ceux qui sont dans l’armée comme Forestier vont le côtoyer. Et il a un rôle important puisqu’il va faire la carrière de ce Forestier tout en s’intéressant de très près à sa femme, grâce à un certain nombre de rebondissements romanesques… Dans le « grand fleuve », les destins se côtoient.
Ce tome 1 de Bleu Blanc Rouge s’arrête en 1848, et la France ne cesse de combattre, que ce soit à l’intérieur ou hors de ses frontières… Et aucun de vos personnages n’a au fond le beau rôle, chacun louvoie entre « le vice et la vertu » en quelque sorte…
M. G. : Ni l’historien ni le romancier que je suis ne saurait définir ce que signifie « avoir le beau rôle »… Je crois que ce qui est intéressant dans un roman, ce sont les personnages complexes : il doit y avoir en chacun d’eux une part de sainteté et une part du diable… Pour moi, l’âme d’un roman, donc l’éthique du romancier, est toute simple : c’est mettre de l’ombre là où le lecteur croit que tout est clair, et de la lumière là où le lecteur pense que tout est opaque. Ce qui est passionnant, ce sont les raisons qui poussent les personnages à agir. J’ajoute que tous les grands romans qui ont traité de cette période, je pense notamment à Quatre-vingt-treize de Hugo ou aux Chouans de Balzac, ne sont pas des romans manichéens, que tous ces personnages ne sont ni tout à fait bons ni tout à fait méchants mais réagissent selon leurs convictions du moment. Pour revenir à Bleu Blanc Rouge, et par exemple à Maximilien Forestier, c’est un officier patriote sorti du rang qui, pourtant, est amené à participer au pillage de l’Italie, constituant ainsi sa fortune, et cependant un homme vertueux. Quant à Philippe de Taurignan qu’on va guillotiner, c’est un noble éclairé, un homme digne de respect qui a des valeurs humanistes proches de celles des révolutionnaires mais il est fidèle à son Roi. Ce que je souhaite, c’est respecter la liberté des destins et préserver aussi la liberté du lecteur. Car je crois que le lecteur doit avoir la possibilité, face à des personnages qui ne sont pas tout d’une pièce, de choisir ses héros personnels dans cette multitude de gens qui ne sont pas tout blancs… ou tout bleus !
Dans une suite romanesque de ce genre, avec autant de personnages, est-ce que vous n’êtes pas amené à vous conduire un peu comme un metteur en scène ?
M. G. : C’est vrai que le roman tel que je le conçois participe de la mise en scène… Et c’est d’ailleurs aussi un peu le cas pour mes biographies, sans doute parce que je suis un enfant de l’image. Mon univers a été celui du cinéma et, d’une certaine manière, on ne peut plus écrire comme si on vivait dans un monde où seuls les mots importent, sans dispositif scénique en quelque sorte. Bien que le théâtre ait été inventé il y a bien longtemps, et donc déjà l’idée de mise en scène… Disons que je me sens plus influencé par le cinéma. Il y a donc toujours une mise en scène des mots, mais l’essentiel n’est pas là, je veux montrer la vie singulière et l’Histoire, et pour cela il faut utiliser un zoom : c’est le rôle de l’écriture et de la composition du roman.
Avez-vous, dans Bleu Blanc Rouge, un personnage préféré ?
M. G. : Oui, je dois reconnaître que j’ai non pas une mais des lignées préférées… Je crois que la famille Forestier a toute ma sympathie ! Ainsi que les Taurignan. Ce sont ces deux lignées-là qui me séduisent le plus, dont je me sens le plus proche. Mais je ne crois pas avoir été injuste avec les autres personnages, ils ont chacun leurs mobiles, leurs raisons, ils sont différents, voilà tout.
Dans l’album illustré qui accompagne votre roman, vous écrivez à propos d’une toile de Dali intitulée Le Chevalier de la mort : « De 1789 à 1999, ces deux siècles d’Histoire ont été souvent parcourus par le Chevalier de la mort entouré de nuées sombres. Mais tant de fois des hommes ont brandi le drapeau Bleu Blanc Rouge comme le symbole de la liberté qu’on ne peut désespérer de l’avenir… »
M. G. : Je pense en effet que ces deux siècles d’Histoire – et particulièrement le XXe siècle par rapport à tous les autres – ont été marqués par, je dirais, l’anthropophagie. Parce que l’Histoire mange de la mort… C’est clair, elle mange de l’homme, en tous cas elle l’a fait jusqu’à aujourd’hui. Et se voiler la face devant cette réalité, c’est l’astuce des lâches qui se font passer pour des naïfs, sachant que cette naïveté-là est plutôt criminelle… Il vaut mieux regarder les choses en face ! Ainsi je crois que Le Chevalier de la mort – pour reprendre ce titre du tableau de Dali – parcourt notre Histoire et enfonce ses sabots très particulièrement dans notre siècle…
Cela dit, je fais confiance à la seule loi de l’Histoire : la surprise. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’inéluctabilité. La surprise, c’est la liberté des individus, et c’est la seule loi qui n’a jamais été mise en défaut. Parce que personne ne pensait par exemple, du moins pas d’une manière aussi rapide, à l’effondrement du communisme… Un certain jour, par une fissure à peine visible dans un mur (c’est le cas de le dire !), l’Histoire s’est engouffrée de façon imprévisible. Car même si, à n’importe quelle période historique, celui qui résiste est décapité, fusillé, torturé ou massacré, curieusement – et c’est ça la surprise – à toutes les époques, il y a des gens qui l’ont fait… Même si c’est raisonnablement, rationnellement, stupide. Il y a toujours dans un groupe un individu ou plusieurs qui refusent ce qui paraît inéluctable… Et c’est un peu cela, aussi, le sens de ce livre : dire au moment où la France se dissout dans l’Europe et l’Europe dans le monde qu’il y a toujours la surprise et toujours le refus, on appelle ça la résistance…