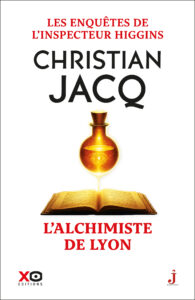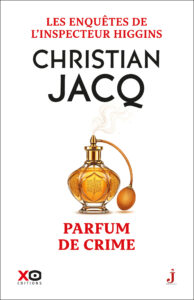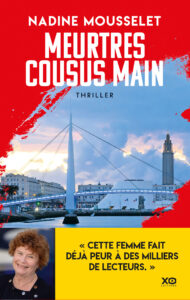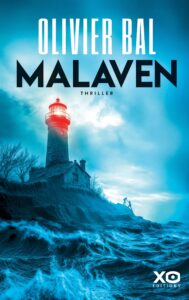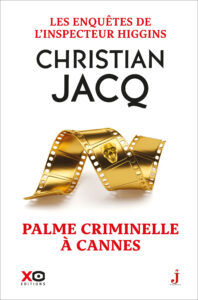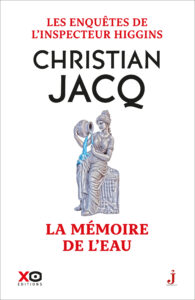L’hôpital est un monde passionnant, c’est le lieu où s’affrontent la vie et la mort, la souffrance et le désespoir, et le médecin est souvent, avec tous les soignants autour de lui, le dernier lien qui retient encore dans notre monde des gens menacés dans leur intégrité, dans leur vie. C’est un univers passionnant, redoutable, un univers où les enjeux sont tout sauf neutres et anodins.
Le roman est un excellent moyen de se dégager des contraintes que la rigueur scientifique impose. Tout en restant vrai au plan scientifique, il donne la liberté de mettre en valeur, à côté des explications, à côté des techniques, tout ce qui touche à l’âme, à la grandeur de ce qui anime ceux qui sont là pour soigner et pour aider. Donc de laisser s’évader l’esprit vers d’autres dimensions qui sont celles de la compassion, de l’amour, de l’intérêt de l’autre.
Pourquoi plus particulièrement un thriller, et à New York ?
Un thriller, parce que dans la construction d’un roman policier, d’une histoire à suspense, on retrouve des ingrédients de ce que vivent les médecins, et les cancérologues en particulier, dans la lutte contre la maladie : l’idée du compte à rebours, du temps limité qui passe inéluctablement et contre lequel il va falloir lutter pour gagner la partie, l’idée aussi que cette maladie cachée et sournoise se défend du mieux de son intelligence, avec l’objectif de tuer le malade. Dans cette lutte contre le cancer, chaque moment de faiblesse, chaque moment d’incertitude est mis à profit par la maladie pour gagner du terrain, pour progresser et ronger davantage la vie dont elle essaie de s’emparer. Finalement, tout ceci est très proche des notions qui sont à l’œuvre dans un thriller.
Mais la deuxième raison tient aussi sans doute au fait que je suis un passionné de cinéma.
Ce livre se passe à New York parce que j’y ai vécu et travaillé dans un laboratoire de recherches de l’hôpital Mount Sinaï, et que j’y ai connu des moments exaltants à la fois par la qualité des recherches de l’équipe dans laquelle je travaillais, mais aussi par la vie trépidante que j’y ai menée, à l’époque, avec ma femme et mes enfants. Cette ville, par sa construction, par son effervescence permanente, m’a semblé être un lieu idéal pour mettre en scène les protagonistes de mon histoire et les faire se confronter les uns aux autres, avec leurs faiblesses, leurs inquiétudes, leurs doutes et en même temps leur courage.
Avez-vous parfois l’impression, en face de vos malades, d’avoir affaire à des personnages de romans ?
La vie d’un médecin cancérologue hospitalier est très proche de l’univers romanesque. A chaque fois qu’un patient entre dans mon bureau, il me raconte sa vie, ce qui le touche à cet instant et qui tient du désespoir, de la menace qui pèse sur sa vie, sur ses organes, sur son intégrité corporelle. Et moi je suis là, en écoute. C’est l’une des choses les plus importantes, cette écoute nécessaire qui engendre la confiance.
Toutes ces histoires que mes patients me racontent en font des personnages. S’ils ne se plaçaient pas dans cette perspective, ce serait trop dur à vivre. La vie qu’ils exposent est certes la leur, mais ils me la racontent comme une histoire. Et l’attitude du médecin est un jeu d’acteur. Il faut imaginer la fin de la journée d’un cancérologue, quand il a accumulé l’expression de tant de souffrance, d’inquiétude et de désespoir… Pour pouvoir continuer de vivre, de croire dans sa vie comme dans celle de ses proches, il doit devenir stoïcien ; considérer que tout ce qui arrive est écrit et qu’il marche le long de son chemin en essayant d’être le meilleur possible, tant au plan technique qu’au plan humain.
Ces deux personnes qui vont déterminer cette relation à la fois unique, singulière mais tant de fois répétée sont finalement des personnages qui jouent le roman de la vie et de la mort.
Votre roman met en scène beaucoup de personnages féminins. Entretiennent-elles un rapport particulier à la maladie, et à la médecine ?
Trente années d’expérience du cancer m’amènent à être émerveillé devant le courage de ces femmes. Elles sont frappées doublement. Dans leur corps bien sûr, mais plus encore lorsque le cancer touche ce qu’il y a de plus féminin en elles (seins, utérus…) et qui est fondateur de leur identité. C’est un courage extraordinaire qu’elles ont tout au long de ce parcours de souffrance, y compris quand elles sont face à la mort. Il ne peut y avoir de la part de celui qui est en face d’elles autre chose que de l’admiration et de l’émerveillement.
Ce courage dont elles font preuve à l’occasion de ce cancer, elles l’ont souvent déjà manifesté lors d’un accouchement. Quel homme aurait le courage d’accepter d’être enceinte, d’accepter de voir cet enfant grandir en lui et de savoir que ça se terminera par un accouchement, avec tout ce que ça comporte comme souffrance et comme risques ?
Les femmes sont sans doute ce qu’il y a de plus fort dans l’humanité, parce qu’elles sont à la fois source de vie au sens propre, mais aussi dans la mesure où elles témoignent de la valeur de la vie par l’exemplarité de leur parcours.
David, le jeune médecin du Coffre aux âmes, s’incline devant les mystères sacrés auxquels il est confronté. Quel est votre point de vue de scientifique ? Est-ce une question à laquelle vous avez apporté une amorce de réponse ?
Il serait prétentieux de ma part d’imaginer une seconde apporter une quelconque contribution à ce grand questionnement de l’homme. Quel est le sens de sa présence sur terre ? Y a-t-il une vie après la mort ? A-t-on une âme ? Que fait-elle ? Où est-elle ? A quoi sert-elle ?
Dans la mise en scène de cette problématique de la vie après la mort, j’ai voulu que s’affrontent ou se confrontent ces deux philosophies, ces deux modélisations de la médecine : celle qui considère que l’important est l’Autre et celle qui considère que la technique prime.
Je crois en Dieu. Je crois qu’il est nécessaire de pouvoir s’accrocher… Je revendique le droit à cette faiblesse qui sera bien pratique au moment où j’aurai peur de mourir. La médecine que je pratique est la médecine qui se bat contre la mort. Je vis avec ceux qui vont mourir, car bien souvent, quand la notoriété vient, vous n’avez plus que les cancers les plus graves à soigner, donc vous accompagnez encore plus souvent les gens vers la mort. Il faut imaginer ce que c’est de vivre après avec le souvenir de toutes ces voix que l’on n’entendra plus et de tous ces visages que l’on ne reverra plus. C’est une telle souffrance qu’elle vous impose l’idée de la mort de tous ceux que vous aimez. Il faut trouver l’anesthésie à cette souffrance, le moyen de continuer, d’ouvrir la porte et de recevoir un nouveau malade habité, torturé par l’angoisse. Il faut trouver la morphine de l’âme et il n’y a pas de médicament pour ça, sauf peut-être une « idée de Dieu ».
Deux conceptions de la médecine s’affrontent dans ce roman. Quels en sont les enjeux, en particulier pour les malades ?
La médecine à l’époque d’Hippocrate était fondée sur un concept simple : Primum non nocere, d’abord ne pas nuire. Parce que cette médecine était impuissante, elle était simplement accompagnement, fantasme qui rassurait avec des potions, à cheval entre la magie et la véritable pratique scientifique primitive. Elle se devait d’être compassion, de compenser son manque de puissance par l’empathie.
Dans les années soixante-dix, quatre-vingt, après des siècles de découvertes, on va aboutir à une médecine qui devient une science et non plus un art. C’est-à-dire une médecine qui trouve tout son sens dans la maîtrise de techniques capables d’apporter à l’homme le soulagement et la guérison. Force est de constater que même si ces espoirs avaient une certaine légitimité, les gens continuent de souffrir, de mourir de choses banales. Quelle est donc la valeur de cette puissance technologique, si elle est jugée à l’aune de ses échecs ?
Aujourd’hui plusieurs questions se posent : la médecine est-elle un art ou une science ? Quel est le sens de l’acte médical ? La médecine ne trouve-t-elle son sens que quand elle est la maîtrise d’une pratique, d’une technique ? Quand je m’assieds au bord du lit d’un malade qui va mourir, que je lui tiens la main et lui parle cinq minutes, est-ce que je fais encore de la médecine ? Est-ce un acte médical alors qu’il n’y a pas eu de prescription, aucun examen, simplement de l’écoute et des paroles, un contact entre deux peau, entre deux mains ?
Je suis persuadé que dans ce témoignage d’affection envers un être qui va bientôt mourir et pour qui je n’ai rien pu faire, je continue de faire de la médecine et je fais probablement ce qu’il y a encore et toujours de plus important dans la médecine : démontrer qu’elle est d’abord et avant tout intérêt pour l’autre. Et pas l’autre puissant, l’autre qui va bien. Non, l’autre qui n’a à offrir que sa faiblesse, sa fracture, son doute.
Vous racontez notamment dans ce roman la découverte des premiers traitements contre la leucémie…
Un jour de 1943, l’aviation allemande bombarde le port de Bari et des bateaux citernes contenant du gaz moutarde coulent, notamment le John Harvey. Les marins de ce bateau vont être aspergés de gaz moutarde. Un médecin militaire américain, le Dr Alexander, va faire des autopsies et constater qu’après quelques jours, les cadavres n’ont plus de globules blancs dans le sang, pas plus que de ganglions. Une fois démobilisé, il pense à une maladie qui tue des milliers d’enfants, la leucémie aiguë, et correspond à une prolifération excessive de globules blancs dans le sang. Il se dit alors que si le gaz moutarde est capable de réduire les globules blancs dans le sang et de diminuer la taille des ganglions chez des matelots sains, peut-être peut-il le faire sur des enfants. Il fait d’abord l’expérience sur des souris et constate qu’elles guérissent.
En 1947, il injecte pour la première fois à un malade américain atteint de leucémie aiguë du gaz moutarde. A la stupéfaction du monde entier, il obtient la première rémission d’une maladie maligne par un produit chimique. C’est la naissance de la chimiothérapie. Aujourd’hui ce médicament existe toujours, c’est la méchloréthanine. Par son observation et sa détermination, le Dr Alexander a transformé une arme de guerre en une arme de vie.
La guerre est toujours pour la médecine l’occasion d’immenses progrès. Elle aboutit à des situations extrêmes en matière d’atteinte de l’intégrité de l’homme et c’est dans ces situations qu’elle apprend beaucoup…
Les grandes découvertes en médecine sont-elles souvent le fruit du hasard ?
Pasteur disait que le hasard ne sourit qu’aux esprits préparés. On peut programmer la recherche mais on ne peut programmer la découverte. Donc la découverte et les progrès viennent toujours du hasard, du jeu du hasard.
Mais le hasard à lui seul ne suffit pas, il faut aussi que ceux qui cherchent aient l’idée d’observer… Deux grandes qualités sont nécessaires : un esprit préparé, disposant des informations et de la culture nécessaires pour comprendre les phénomènes observés, et une ouverture d’esprit prédisposant à accepter l’inacceptable, l’inattendu. Il faut accepter de croire que ce que l’on voit n’est pas une erreur mais simplement la révélation de ce que l’on va découvrir.
Quand on regarde l’histoire de la médecine, on constate malheureusement qu’elle n’est pas toujours le champ de l’activité humaine le plus ouvert au progrès, aux changements et à l’inhabituel. C’est probablement, au contraire, le lieu des plus forts dogmatismes, du plus fort conservatisme, alors même que la science appliquée chez l’homme a permis des progrès considérables depuis Hippocrate. On constate aussi malheureusement qu’à chaque fois ces progrès ont été appliqués à l’homme après de véritables révolutions des comportements, et non pas de simples évolutions. La « Faculté » a toujours eu tendance à résister aux changements, à chercher le confort de ce qu’elle savait plutôt que le doute de ce qui allait advenir.
Quelles sont les places du travail en équipe et de la collaboration internationale dans cette recherche ?
Elles sont primordiales. Le progrès « ne vaut que s’il est partagé ». Que vaudrait l’éthique qui est censée animer la pratique de tous les médecins du monde, si certains d’entre eux acceptaient que ce qui est disponible pour ses concitoyens ne le soit pas pour d’autres ?
Il faut tendre vers l’universalité de l’accès aux soins, à des soins de qualité, au respect de l’être humain. C’est sans doute l’un des plus grand défi de l’humanité.
Pensez-vous que l’éthique médicale sera toujours plus forte que les enjeux économiques ?
Je le crois profondément. Je crois qu’encore une fois, le balancier reviendra en arrière. Que vaut la vie en termes économiques ? Posez la question à ceux qui vont mourir et vous verrez ce qu’ils vont vous répondre. Avant que la mort ne les menace, c’étaient des citoyens qui payaient des impôts et trouvaient parfois que c’était trop cher. Après… Je crois que c’est affaire de pédagogie, de confiance dans la capacité de chacun d’entre nous à comprendre les véritables enjeux de nos sociétés.
Quels progrès peut-on espérer à l’heure actuelle, quelles sont les voies de recherche ces dernières années ?
Le progrès, c’est l’éradication de la souffrance. La souffrance n’est pas nécessaire. Pendant longtemps on a estimé, pour des raisons théologiques, qu’elle était rédemptrice et donc on l’a acceptée comme un fait acquis, un fait indéniable. L’éradication des souffrances mettra du temps, ce n’est pas quelque chose que l’on ne peut atteindre facilement, mais je crois que c’est un objectif que l’on peut se fixer. On peut imaginer une alliance, devenue alors invincible, entre tous ceux qui ont affaire à la souffrance des hommes – les politiques, les industriels, les médecins, les soignants, les chercheurs, les malades. Je crois que c’est de l’union que naîtra l’invincibilité et donc la victoire contre la souffrance et la mort.
La mort est acceptable, elle est nécessaire, elle donne l’intérêt à la vie. C’est la mort infâme, c’est la mort dans la souffrance, dans la déchéance, dans la dégradation qui n’est pas acceptable.
Les voies de recherche sont innombrables. L’idée prédominante aujourd’hui, c’est qu’après avoir imaginé que l’on pourrait détruire toutes les cellules cancéreuses chez un malade, quel qu’en soit le prix, on pourrait maintenant obtenir une paix armée entre le malade et son cancer. Quand vous avez une hypertension artérielle ou un diabète, vous ne guérissez jamais. Vous acceptez simplement que ces maladies ne se manifestent plus en échange de la prise régulière de médicaments et d’un suivi. Pour le cancer, on estime que la seule issue possible est la victoire définitive de la médecine sur la maladie. Or je pense que lorsque l’on aura mieux compris comment fonctionne la cellule cancéreuse, on pourra vivre avec le cancer.
L’une des caractéristiques les plus importantes des cellules cancéreuses est leur immortalité. Une cellule normale vit quelques heures, quelques jours puis vieillit et meurt. La cellule cancéreuse, elle, ne meurt jamais. On sait aujourd’hui par quel mécanisme elle est arrivée à arrêter l’horloge qui lui donnait son temps de vie ; on prépare donc des médicaments capables de remettre en marche cette horloge. Certes, cette cellule est cancéreuse, mais quand elle sera morte, elle ne sera plus une menace pour le malade.
Les cellules cancéreuses ont aussi comme caractéristique leur capacité à se diviser indéfiniment. Chez une cellule normale, un signal est donné pour faire cesser le phénomène de division lorsque le renouvellement cellulaire est fait. La cellule cancéreuse ne reçoit plus ces messages. Elle n’est capable ni d’émettre ce message d’arrêt, ni de le recevoir, elle va donc se multiplier à l’infini. Aujourd’hui on teste chez l’homme des produits capables de remettre en fonctionnement ces mécanismes de contrôle. Le cancer sera peut-être toujours présent dans le corps du malade, dans son foie, dans son sein ou dans son utérus, mais ce cancer ne se développera plus.
Des dizaines de pistes nouvelles et prometteuses s’ouvrent ainsi devant nous. Et avec elles, un nouveau droit à l’espoir. Donc, d’une certaine façon, un nouveau droit de vivre pour le malade.