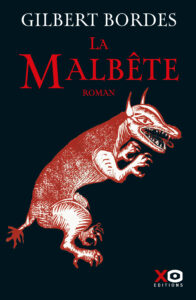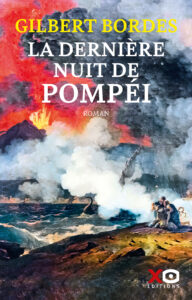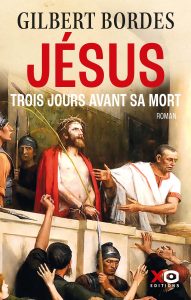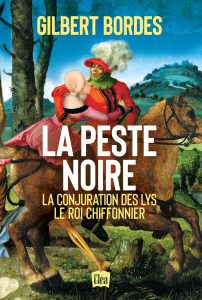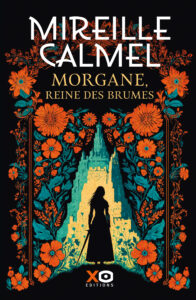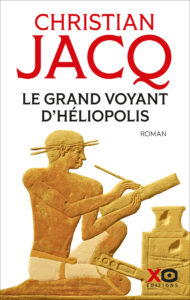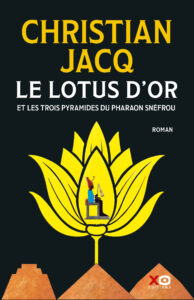J’ai toujours aimé les grands romans d’aventures avec des personnages hauts en couleurs, animés d’une force humaine hors du commun. Dumas et Giono sont mes deux maîtres, chacun dans leur genre. Dumas est le maître incontesté dans l’art de ra-conter des histoires ambitieuses et palpitantes. Giono m’a toujours beaucoup touché dans sa manière de parler du lien charnel qui nous unit à la terre, de cette sensualité profonde des saisons, des odeurs, de ce qui constitue les terroirs. Ces deux tendances ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je veux raconter des histoires prenantes, de fortes intrigues, sans oublier la place de l’homme dans son environnement.
Pourquoi notre Dumas et tous nos grands populistes sont tant appréciés ? Parce qu’ils écrivent pour leurs lecteurs. Mon ambition, c’est de faire la même chose : donner aux gens du plaisir à lire l’histoire que je leur raconte. Imiter Dumas en y ajoutant la sensibilité de mon époque. Je n’ai qu’un souhait : faire une littérature proche des gens, donner quelques instants de bonheur à ceux qui me lisent.
Vous avez choisi la période de la Peste noire. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Ce roman marque un tournant dans mon travail. Depuis des années, j’avais envie d’écrire des romans à la manière des grands maîtres du XIXe siècle. Pour cela, il me fallait un grand sujet, une histoire forte, une intensité dramatique qui ne se trouve que lorsque l’homme doit faire face à ce qu’il ne comprend pas. Et j’ai tout de suite pensé à la peste noire, cette épidémie venue d’Asie qui a terrifié tout le monde et tué presque la moitié de la population européenne. Néanmoins, malgré ses ravages, la vie a continué, des gens ont survécu.
J’ai également choisi ce sujet car le XIVe siècle est une époque peu connue de notre histoire et qui, pourtant, m’a toujours fasciné. Elle est d’une richesse extraordinaire. Toutes les pensées modernes ont germé dans les contradictions de ce siècle dont la peste noire est l’aboutissement : le protestantisme est né avec les Fraticelles, les villes se sont émancipées du pouvoir médiéval, les idées du siècle des Lumières ont germé dans ce monde de grande souffrance.
Vous voulez dire que, même historiquement éloignées, les problématiques de votre roman restent très actuelles ?
Pourvu que l’histoire soit forte, un roman peut se passer à n’importe quelle époque ; mais il me semble que pour toucher les lecteurs, il doit se trouver au centre de leurs préoccupations. Les hommes du XIVe siècle ont été confrontés à une menace qu’ils ne pouvaient pas maîtriser, la peste. Nous ne sommes pas différents de nos ancêtres de la fin du Moyen Âge. Tant d’épées de Damoclès sont suspendues au-dessus de nos têtes que les lecteurs actuels se retrouvent dans les angoisses de ces hommes qui ont vécu sept siècles avant nous.
La grande peste a éclaté il y a bien longtemps, mais si elle est restée dans notre mémoire collective, c’est bien qu’elle symbolise une menace encore présente. On l’a vu avec la grippe aviaire qui, forcément, tôt ou tard, deviendra dangereuse pour l’homme. Pourtant, au Moyen Âge, le peuple voyait dans la maladie le courroux de Dieu et se trouvait complètement démuni. Bien sûr, aujourd’hui, une épidémie ne resterait pas sans explications, ni sans remèdes. Mais en même temps, les possibilités de propagation sont telles que nous pouvons être pris de court. La peste qui se déplaçait à la vitesse des hommes et au galop des chevaux, a mis presque une année pour aller de Marseille à Paris. Aujourd’hui, un virus dangereux se répandrait sur les cinq continents en moins d’une journée…
Dans votre livre, l’on découvre à la fois la France des petites gens, mais également l’intimité des rois, la cour et les chevaliers. Pourquoi avoir choisi de mêler ces deux univers ?
Il y a tellement de différences entre les grands seigneurs et les petites gens, un tel fossé les sépare qu’il est impossible de les faire cohabiter. Ils vivent sur le même territoire, ils se croisent, il peut leur arriver de se parler, mais ils ont tous la certitude de ne pas être de la même espèce !
Ils avaient pourtant au fond d’eux, les mêmes croyances, la même conscience du temps qui passe ; ils se posaient les mêmes questions quand ils s’agenouillaient devant un crucifix. Ils étaient également intelligents ou idiots, ils avaient la même sensibilité, éprouvaient les mêmes sentiments de bonheur ou de chagrin. Et surtout, ils étaient égaux devant la maladie et la mort.
Les héros de l’histoire sont à la fois des personnages historiques, mais aussi inventés. Quelle est la part de fiction et de vérité dans ce roman ?
Tout est vrai et en même temps, j’ai tout inventé ! L’Histoire ne nous a rapporté des personnages importants qu’un nom, parfois un surnom, des actes, des commentaires d’historiens, mais cela n’en fait pas des personnages vivants. Jean II que l’on dit « Le bon » était un piètre roi, passionné de chevalerie, mais faible et mauvais politique. Je l’ai fait grand, mal bâti, avec des membres trop longs parce que c’est ainsi que je l’imagine. Charles le Mauvais était intrigant, j’en ai fait ce petit homme pétillant de verve, ce bel adolescent pervers. Je me suis laissé aller, comme l’a fait Dumas avant moi, à réinventer ces personnages historiques pour leur donner vie.
Dans mon roman, j’ai respecté l’Histoire en laissant libre cours à mon imagination dans ce qu’elle ne nous dit pas, dans ses zones d’ombre. Ainsi, il est vrai que Louis X a eu un fils, Jean le Posthume. Selon l’histoire officielle, ce Jean Ier est mort trois jours après sa naissance. Mais selon l’histoire officielle encore, un Italien, un certain Giannino Guccio s’est prétendu être Jean Ier. Ça, c’est vrai : ce Guccio a même réussi à réunir une armée de partisans. Il a été vaincu en Provence, comme je l’ai ra-conté. Était-il le véritable fils de Louis X ? Personne ne le sait, mais pendant près de trente années, un grand nombre de nobles a contesté le trône des premiers Valois et intrigué contre eux. Philippe VI et Jean II, parce qu’ils étaient faibles, ont été les rois les plus contestés par leurs pairs de toute l’histoire de France. Ils ont dû, pour rester en place, déjouer une multitude de complots.
Quant à la reine Clémence, la « reine blanche » – le blanc étant la tenue de deuil des reines – a été la veuve de Louis X à 23 ans. Mais 23 ans, c’est bien jeune pour n’avoir d’autre avenir que la solitude de son petit château de Vincennes ! J’ai inventé ses amours avec le troubadour Renaud d’Aignan, mais elle recevait beaucoup de musiciens, de poètes.
Et puis les anecdotes que je raconte sont toutes inspirées de ce qui se passait réellement à cette époque. Par exemple, les boucs étaient bien utilisés par les puissants pour se prémunir contre la peste. De tout temps, ces bêtes ont eu la réputation de chasser la maladie. Dans mon enfance encore, les vieux paysans gardaient un bouc dans leur étable pour que leurs vaches restent saines !
Quant à l’héroïne, Eugénie, c’est un personnage fictif. Est-ce cependant plausible, qu’au Moyen Âge, une jeune femme prenne la tête d’une troupe d’hommes ?
La société du Moyen Âge était beaucoup plus libre qu’on ne le pense souvent. Les femmes y jouaient un rôle considérable, surtout dans la France du Sud, l’Occitane. L’Église leur interdisait de se vêtir en homme, mais beaucoup n’hésitaient pas à revêtir la cotte de maille et manier l’épée à l’occasion. Des femmes célèbres en sont l’illustration, Aliénor d’Aquitaine au XIIe siècle, et bien sûr, plus tard, Jeanne d’Arc, des femmes étonnantes de courage, capables de conduire et de galvaniser des troupes entières. Eugénie a l’étoffe de l’une de ces grandes héroïnes de l’Histoire.