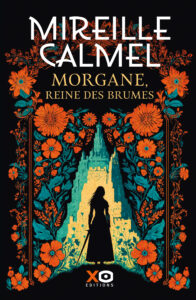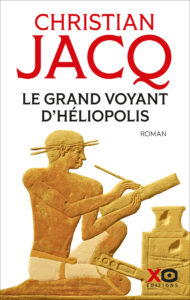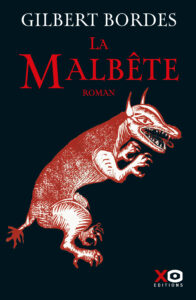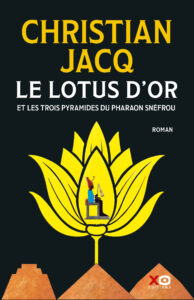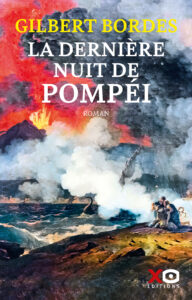En effet. Entre-temps, j’ai écrit plusieurs essais. Cela dit, ce roman me trottait dans la tête depuis des années. La trame se dessinait au fur et à mesure, à travers des phrases, des noms, des lieux griffonnés sur des fiches. Puis il a fallu que je me documente sur cette période historique qui est aussi celle qui a marqué mon enfance. Soudain, la lumière a jailli. Un nom, d’abord : Ruth Rotstein, ainsi que s’appelait la sœur couturière de ma mère, que je n’ai jamais connue, mais dont j’ai beaucoup entendu parler. Enfin, un lieu, comme une évidence : Shanghai. Cette ville lointaine, dont j’ai rêvé enfant et qui, bien que de l’autre côté du globe, faisait elle aussi partie de mon histoire.
Votre roman commence par la description d’un atelier de couture. Était-ce important pour vous de choisir un lieu de création et d’élégance qui tranche avec ce contexte de persécutions ?
J’ai beaucoup appris dans les romans. Par exemple, grâce à la description si fidèle de Balzac dans les Illusions perdues, j’ai su comment fonctionnait une imprimerie il y a deux siècles. Curieusement, c’est la précision qui introduit la poésie dans le texte. La Juive de Shanghai commence par la description d’un atelier de couture berlinois dans les années 1930. C’est un moyen de situer l’action du roman, de marquer le contexte du récit et sa temporalité. Vous avez raison de souligner que l’atmosphère d’élégance et de calme qui émane de cet atelier de haute couture tranche avec la violence de la rue et le contexte de persécution des Juifs. La tension et le drame naissent de cette confrontation.
Au fil de l’histoire, nous suivons le destin hors du commun de deux femmes que tout oppose et qui vont se rapprocher. Comment est née cette amitié extraordinaire entre Ruth et Clara ?
L’amitié naît d’ordinaire d’un événement imprévisible. Comment une Juive de Varsovie destinée à devenir une modéliste de renom à Berlin peut-elle, un jour, rencontrer une bourgeoise allemande devenue révolutionnaire ? Comment, à un moment donné, toutes deux opprimées, ont-elles découvert que Shanghai, cette ville lointaine et presque inaccessible, n’était pas seulement un agglomérat immense où se côtoyait un monde interlope d’espions, de trafiquants d’opium et de résistants, mais pouvait devenir un havre pour les persécutés ?
Lors de leurs voyages respectifs, elles traversent des épreuves initiatiques et forgent leurs personnalités. Et, par correspondance, leur amitié.
Pouvez-vous nous raconter quelques péripéties de cet ahurissant voyage vers Shanghai ?
Avant la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe centrale comptait plus de cinq millions de Juifs. Face aux persécutions nazies, ce peuple a trouvé toutes les frontières closes. Seule une ville était prête à l’accueillir : Shanghai. Pour ceux qui voulaient tenter l’aventure, deux moyens se présentaient : le bateau de Hambourg ou de Marseille, ou le train de Lituanie ou de Biélorussie, à travers les plaines de Sibérie, jusqu’au Japon. Clara décide de prendre le bateau à Hambourg, tandis que Ruth quitte Varsovie – ville qui m’a vu naître et à laquelle je rends hommage dans ce livre – avec les siens et prend la route vers la Lituanie d’où ils espèrent pouvoir atteindre le Japon, puis Shanghai, via la Russie.
Le roman s’appuie sur une réalité historique méconnue : la présence d’un ghetto juif à Shanghai. À quoi ressemblait ce ghetto et, plus généralement, cette ville ?
Le ghetto de Shanghai, personne ou presque n’en a entendu parler. Pourtant, les touristes qui s’aventurent aujourd’hui dans cette mégapole peuplée de 27 millions d’habitants peuvent visiter un musée installé dans l’ancienne synagogue qui relate la vie de ces quarante et quelque mille Juifs européens qui y ont trouvé refuge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce ghetto a été créé dans la Concession française de la ville par les Japonais sous la pression des Allemands, alors alliés de l’empire du Levant. Il s’agissait en vérité d’un compromis entre la volonté des nazis d’exterminer les Juifs jusqu’au dernier, et le respect des Japonais à l’égard des étrangers, quels qu’ils soient. Précisons
que Shanghai se trouvait à l’époque sous domination japonaise.
Parmi vos personnages, il y a ce consul japonais qui joue un rôle clé. Il a réellement existé et a permis de sauver des milliers de Juifs. Était-ce une façon pour vous de lui rendre hommage ?
Le périple de Ruth et ses proches, parsemé de mille embûches dignes du voyage de Michel Strogoff de Jules Verne, les conduit d’abord à Kaunas, seconde ville de Lituanie. Ils se joignent à des centaines d’autres Juifs qui se trouvent là à cause d’un personnage historiquement véridique, mais méconnu, et que j’ai moi-même découvert et interviewé lors du tournage de mon film sur les Justes au début des années 1990 : le consul japonais du nom de Chiune Sugihara. Un personnage fascinant. Ému par la situation de ces réfugiés juifs dont personne ne voulait alors, le diplomate a décidé, contre l’avis de son gouvernement, d’émettre autant de visas que possible pour leur permettre de traverser la Russie jusqu’à Kōbe au Japon. À sa manière, Sugihara a sauvé plus de Juifs que Schindler, devenu célèbre, lui, grâce au film de Spielberg.
Ruth, une des deux héroïnes, tient un journal intime très émouvant mais aussi très précieux pour comprendre les enjeux de cette période de guerre et d’oppression. Quelle place donnez-vous à ce carnet ?
L’exode joue dans ce roman un rôle de révélateur et tisse un fil presque invisible à l’œil nu qui met en évidence les sentiments les plus intimes, comme les plus violents, entre les différents personnages : en l’occurrence entre deux femmes, Ruth et Clara. Animées toutes deux d’une volonté de survie, d’une fidélité fondamentale à leurs origines, elles résistent coûte que coûte à cette réalité qui efface tous les principes et tous les préjugés.
Ruth tient un journal qui lui permet de préserver l’essentiel : la mémoire, la sienne et celle de son peuple. J’ai utilisé ce procédé dans La Mémoire d’Abraham – mon livre le plus lu avec six millions d’exemplaires vendus. Une famille, la mienne, survit à travers les siècles grâce
à la lecture d’un rouleau nourri par les témoignages de plus de quatre-vingts générations.
Au fond, plus on vous écoute, plus on se dit qu’on est entre le roman vrai et le récit personnel…
Oui. Chaque auteur s’investit, plus qu’on ne le croit, dans ses personnages. Ainsi Flaubert a pu dire en toute sincérité que Madame Bovary, c’était lui. Ruth, l’héroïne de La Juive de Shanghai, est porteuse de ma mémoire. Elle est née, comme moi, dans une ville d’un million d’habitants, dont presque quatre cent mille étaient juifs. Avec leurs traditions, leur mode de vie particulier, et surtout leur langue, le yiddish, dont j’entends encore la mélodie et qui n’est presque plus parlé de par le monde.
Qu’aimeriez-vous que les lecteurs retiennent de ce roman ?
J’aimerais que mes lecteurs s’imprègnent de cette histoire qui, comme toutes les histoires, paraît ancienne et est pourtant d’une actualité saisissante. C’est pour cela qu’il faut les connaître. Car l’homme qui ne sait pas d’où il vient ne sait où il va. Je suis, comme vous le savez, avant tout un conteur. Et tout conteur ambitionne de partager de la manière la plus attractive qui soit possible les questions qui le tenaillent à travers les récits qu’il compose. Il aime voir naître dans le regard du lecteur l’intérêt, la passion, voire, pourquoi pas, un élan d’identification avec ses personnages, qu’ils soient réels ou fictifs. Parmi mes livres, La Juive de Shanghai est, avec la Mémoire d’Abraham, celui que je considère le plus important.