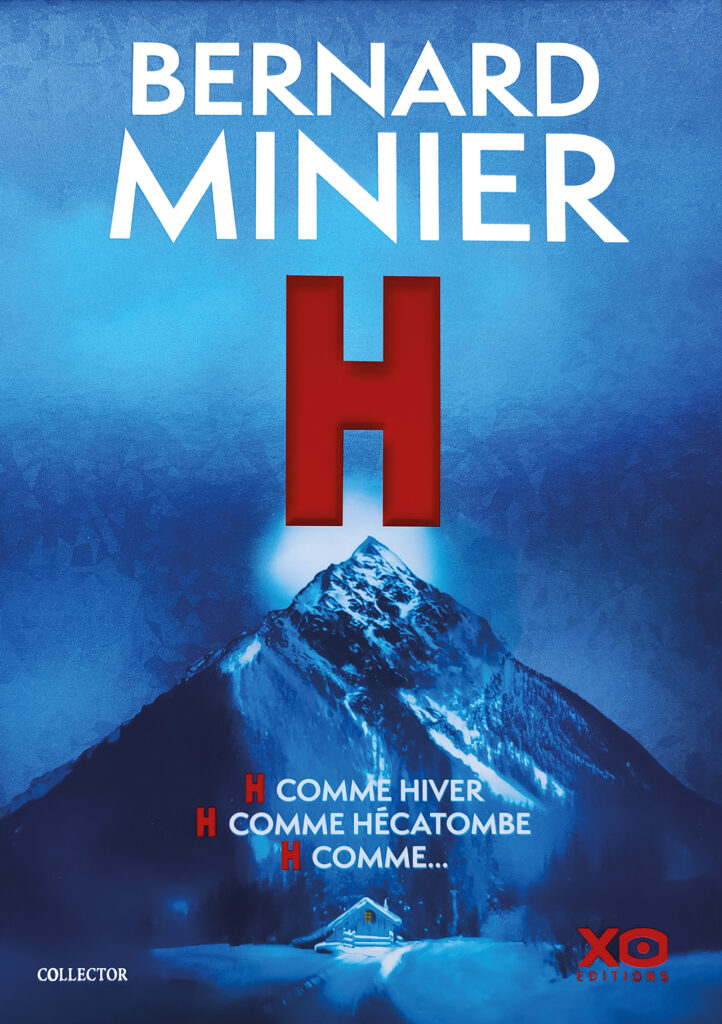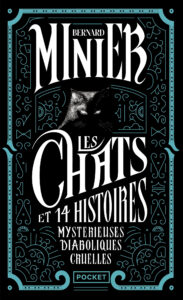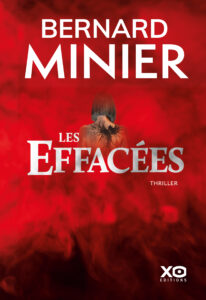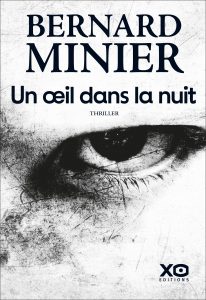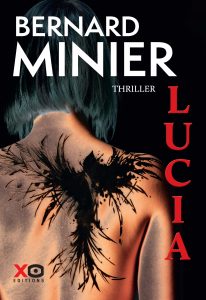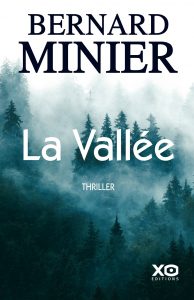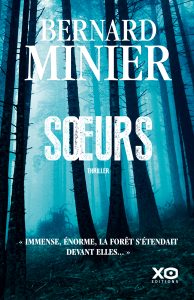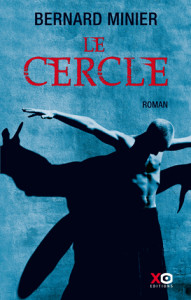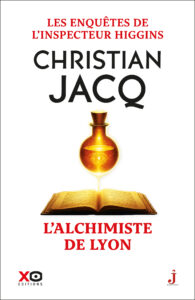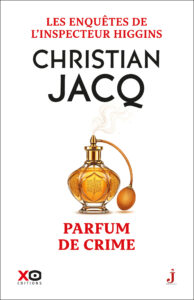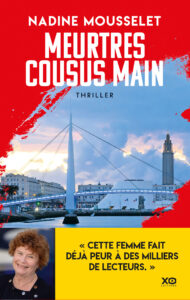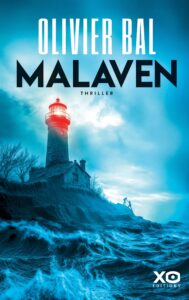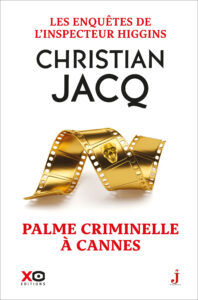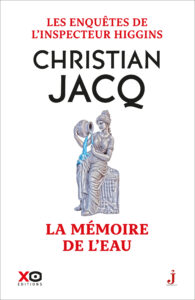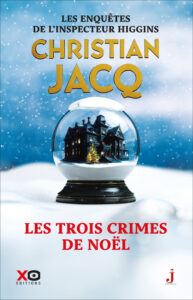Interview de l’auteur
« H comme Hirtmann », annonce la quatrième de couverture. Autrement dit le retour de Martin Servaz et de son « meilleur ennemi » ? Une convocation pour un grand final ?
Disons des retrouvailles… Je n’ai pas fait évader Julian Hirtmann pour rien dans le précédent opus. Cela dit, H est très loin d’être le seul personnage important de ce livre, voire le plus important, et il s’y passe bien des choses à côté de sa traque.
Pour ceux qui ont lu Un œil dans la nuit et se demandent qui se cachait derrière la porte : on aura la réponse ? C’était la dernière scène, très énigmatique.
Absolument. Mais, bien entendu, pas besoin d’avoir lu la précédente enquête de Martin Servaz pour lire celle-ci.
Avec ce thriller, vous décrivez l’incroyable engouement du public pour le true crime, c’est-à-dire pour des documentaires, des livres, des podcasts parlant de crimes réels, souvent épouvantables, de criminels ayant réellement existé ou existants.
Oui, c’est assez sidérant tous ces gens qui se prennent de passion pour le true crime de nos jours. On en trouve partout désormais: sur les plateformes de streaming, sur les chaînes de la TNT, en podcast, sur Youtube, dans des magazines… Savez-vous que 75 % des auditeurs de podcasts de true crime sont des auditrices? Je me suis demandé ce que ça disait de nous, cette fascination pour les crimes réels, fascination qui transcende les générations comme les classes sociales.
Et, dans votre roman, les fans de true crime se lancent sur la piste d’Hirtmann en même temps que les services de police. Ils forment des communautés de détectives amateurs, d’enquêteurs du dimanche, qui échangent sur des forums, s’entraident pour résoudre des cold cases, des meurtres, des disparitions en plongeant dans les profondeurs du Web.
Oui, ça s’appelle du web sleuthing, ça vient de sleuth, «détective» en anglais. Une des premières fois que j’ai découvert ces communautés, c’était dans un doc sur Netflix, Don’t F**k With Cats, qui montrait comment, à partir de vidéos en ligne, des internautes étaient parvenus à identifier et à retrouver Luka Rocco Magnotta, «le Dépeceur de Montréal». Imaginez des centaines de personnes collaborant pour retrouver le coupable d’un crime et ayant à leur disposition le plus gigantesque gisement d’informations de toute l’histoire de l’humanité, une mine de renseignements sur tout et tout le monde: Internet…
Autre peinture marquante dans votre livre: celle que vous faites d’une star de la télé à l’ego impressionnant…
L’idée m’en est venue à la lecture d’une œuvre-phare d’un sociologue américain, Se distraire à en mourir (dont l’édition française était curieusement préfacée par Michel Rocard), montrant les effets de la télé sur notre façon d’appréhender le monde, de déchiffrer les phénomènes. Damien Dix, mon personnage, est le présentateur vedette et le producteur de Tout le monde regarde, le «talk-show le plus regardé de France», et il s’est mis en tête d’interviewer Julian Hirtmann. Et Servaz doit composer avec tous ces gens et cette folie qui s’empare du pays.
Il y a dans H un personnage très attachant: la journaliste de presse écrite Esther Kopelman. Vous reconnaissez-vous dans sa démarche, ses valeurs ?
Esther, on l’a déjà croisée dans La Chasse. Je savais à l’époque qu’elle reviendrait. C’était un personnage trop formidable pour ne pas lui donner plus de place. Quelque part, ses valeurs sont un peu les mêmes que celles de Servaz. Je lisais récemment les mémoires d’un juge d’instruction; il écrit ceci à propos de son métier: «Seule la recherche de la vérité doit le guider, encadrée simplement par le respect de la procédure». Eh bien, disons qu’Esther comme Martin poursuivent le même but, mais s’affranchissent parfois du cadre légal.
Au fond, n’est-ce pas le vrai sujet du livre: la difficulté de plus en plus grande que nous avons à reconnaître le vrai du faux ?
Exactement. Le regretté Michel Serres disait déjà que « notre rapport à la vérité s’est brouillé ». Comment faire pour s’y retrouver dans cette avalanche de fake news, de rumeurs, de théories paranoïaques, de mensonges, de manipulations, de contrevérités, d’accusations sans preuves, d’absurdités? Même les IA trichent et mentent désormais.
L’automne dernier, vous avez publié, avec succès, Les Chats, un recueil de nouvelles écrites dans des registres très différents. Est-ce à dire que vous aimeriez, de temps à autre, vous aventurer vers d’autres horizons littéraires ?
Les Chats m’a en effet donné l’opportunité de m’évader vers d’autres genres que le polar: fantastique, S-F, conte animalier, satire, voire pas de genre du tout… Il faut dire que j’ai écrit bien d’autres choses que du polar avant d’écrire Glacé et que je suis depuis toujours un lecteur « omnivore »: le polar occupe environ dix pour cent de l’espace de ma bibliothèque.
Votre rayonnement à l’international ne cesse d’augmenter. Comment vivez-vous cette notoriété?
Avec bonheur et incrédulité. Quand je vois l’enthousiasme des journalistes étrangers, du public, pour des histoires qui ont un cadre géographique limité : le Sud-Ouest, les Pyrénées sous la neige, la France… Le succès dans les pays scandinaves me fait particulièrement plaisir. Parce que certains de leurs auteurs rencontrent le même succès chez nous et que c’est une terre de polar et de connaisseurs. Mais j’éprouve la même joie quand je me rends en Espagne, dans un village du Nord-Aragon, et qu’il y a cent cinquante personnes dans la salle, ou à Poznań et Wrocław en Pologne, à Prague, à Francfort, à Athènes, à Bucarest, à Bratislava, à Barcelone, à Valence, à Côme (où j’ai pu dîner avec Dario Argento et Abel Ferrara), à Oslo, à Sofia, à Harrogate, etc.
lire toute l’interview
la presse en parle
« Un thriller ultra contemporain. (…) Un roman qui vous vaudra quelques nuits blanches, sans une minute de répit, jusqu’à la chute que je vous promets vertigineuse. »
Augustin Trapenard, La Grande librairie
« Comme parfois chez l’auteur natif de Béziers (Hérault), le thriller prend des atours de critique politique. (…) H est, cette fois-ci, l’occasion pour Minier de critiquer la fascination morbide pour les faits divers, mais surtout de mener une charge sévère contre la « télépoubelle ». (…) Un jouissif jeu de massacre contre la société du spectacle. »
Abel Mestre, Le Monde des Livres
« H, le nouveau polar de Bernard Minier : encore plus sombre, encore meilleur. (…) Dans « H », tout est plus froid, plus sombre, plus explosif aussi. »
Olivier Burreau, Le Parisien
« Bernard Minier est de retour et, soyons honnêtes : H est un bon cru ! »
Bruno Corty, Le Figaro littéraire
« Bernard Minier imbrique thriller classique et thématiques contemporaines, comme le masculinisme et la révolution numérique. Un esthète de la peur. »
Hubert Artus, Parisien Week-end
« Horrifique. Hallucinant. Hardcore. Hypnotique (…) Des polars, il en pleut des cordes mais aucun auteur n’a le charme noir si particulier de Bernard Minier. »
Anne Crignon, Le Nouvel Obs
« Outre le talent de Minier pour le cliffhanger, le suspense et l’épouvante, H a pour spécificité de s’emparer de l’air du temps (…) On dévore cette enquête terrifiante à souhait, embarqués par le talent de conteur de Minier et son regard au vitriol sur notre monde dopé au voyeurisme et privé de boussole morale. Jusqu’au final, étourdissant »
Élise Lépine, Le Point
« Un vrai page turner »
Antoine Leiris, RTL
« Un livre au suspense inégalé »
Laissez-vous tenter, RTL
« À travers H, l’auteur tend un miroir à ses lecteurs, les plonge dans cette zone floue où se mêlent curiosité, voyeurisme, quête de vérité et besoin de frisson. »
RTL Info
« Ô joie ! Martin Servaz est de retour. (…) Formidable raconteur d’histoires, Minier instille du suspense là où il faut, quand il faut. »
Cécile Pivot, Femme Actuelle
« Ce nouveau cru intense, mêlant enquêtes et enquêteurs, victimes du passé et disparues récentes, offre un final qui risque de faire grand bruit… (…) Désabusé et sarcastique, ce nouveau tome, sur fond de course à l’audimat et au scoop, est aussi celui du doute pour Servaz, peut-être trop vieux pour la nouvelle génération de flics et ses supérieurs, peut-être trop malchanceux pour être heureux en amour… Avec, dans les dernières pages, un retournement de situation que personne ne voit venir et qui qui va vous faire avaler de travers !»
Jade Olivier, Version Femina
« Une histoire glaçante et addictive »
Elodie Charriere, Biba
« Le nouveau thriller haletant de Bernard Minier s’annonce comme le succès littéraire de 2025 (…) Un nouveau thriller haletant, sombre et angoissant. »
Victoria Lasserre, Cosmopolitan
« Thriller net et sanglant. (…) Maître de la mécanique de précision, Bernard Minier titille les nerfs dans un thriller diabolique qui tend un miroir sur l’époque »
Gilles Médioni, Marie France
« Le roi du polar signe un thriller prenant et original ancré dans l’époque. »
Eric Floux, Maxi
« Pour ce treizième roman, le maître du polar signe le retour du commandant Servaz. »
BFM TV « Culture et vous »
« Le nouveau thriller décapant de Bernard Minier. »
Pierrick Fay, Les Echos
« Brillant et mené d’une main de maître. »
VSD
« Un polar diablement contemporain. (…) Un rendez-vous clé pour les amateurs de thrillers psychologiques et d’intrigues à couper le souffle. (…) L’auteur offre une réflexion sur la manipulation de l’information et la responsabilité des médias, tout en maintenant un suspense haletant. H s’impose ainsi comme un thriller captivant, ancré dans les préoccupations sociétales contemporaines. »
Inès Lefoulon/ Victor De Sepausy, Actualitté
« Un travail sur les détails qui donne d’autant plus de force et d’impact à ce 13ème roman »
Frédéric Rapilly, Télé 7 jour
« C’est dense, parfois un peu lent, parfois impossible à lâcher. Et quand la lecture se termine, on n’a plus qu’une envie : s’y replonger. »
Camille Brun, Télé-Loisir / Télé 2 semaines
« L’auteur de thrillers explore une nouvelle fois l’âme humaine avec ce qu’elle a parfois de plus noire et de plus secrète, en jouant avec les nerfs des lecteurs. (…) Bref ce H ne faillit pas à la réputation de Minier. (…) Aussi glaçant que l’hiver dans lequel il se déroule. »
Karine Leroy, Paris Normandie
« Pas à pas, livre après livre, Bernard Minier nous entraîne jusque dans les bas-fonds de l’âme humaine… et on en redemande ! »
Florence Dalmas, Le Progrès
« Rien ne manque dans « H » (…) On ne lâche pas ce grand « H » dans lequel on s’installe et où on se laisse mener d’un bout à l’autre par un maître du genre, affûté comme jamais. »
Alexandre Fillon, Le Télégramme
« Bernard Minier en met plein la vue dans ce thriller »
Le Journal de Montréal
«En l’espace d’une grosse décennie, l’auteur français Bernard Minier s’est transformé en une valeur sûre du roman noir et policier. »
Laurent Depré, Dernière Heure
« On dévore les pages. Les coupables ne sont pas ceux que I’on croit. Une célèbre star de télé est même mise à contribution, à ses risques et périls. En parallèle de la terrible intrigue, l’auteur nous donne à découvrir notre époque, sa complexité, ses vices et ses vertus. C’est ce qui rend son récit si… haletant.»
Yves Viollier, La Vie
« Un roman noir, surprenant et provocant »
L’Est républicain
« Il y a encore une fois tous les ingrédients pour captiver le lecteur et le faire réfléchir sur les travers de notre société actuelle, dans le dernier thriller de Bernard Minier. (…) On a l’habitude avec Bernard Minier : ouvrez le livre, vous n’en ressortirez qu’une fois terminé. »
Matthieu Marin, Ouest France
« Un roman mené de main de maître, avec des rebondissements inattendus qui vous coupent la respiration. (…) Attention, grand Minier ! »
Sébastien Dubos, La Dépêche du midi dimanche
« Une chose est certaine, vous ne vous ennuierez pas en plongeant dans H le dernier roman policier de Bernard Minier. Vous vous laisserez emporter par la sagacité de ce policier toulousain. »
Michel Colson, La Dépêche du midi
« Bernard Minier a le chic pour donner vie à des personnages attachants, on le verra encore ici, dans ce roman passionnant »
Bernard Cattanéo, Le Courrier Français
« Bernard Minier prend un virage à 90°C et surprend comme jamais avec un retournement de situation qui demande de bien s’accrocher »
Magali Mustioli-Hercé, Courrier Picard
« Un thriller aux multiples rebondissements (…) Son dernier thriller est un véritable chef d’œuvre. On en redemande. »
Hubert Lemonnier, La presse de la Manche
« H, qui signe le retour du commandant Servaz, est un polar très puissant qui devrait vous tenir en haleine. »
Daniel Gimeno, Ici La Rochelle
« On adore retrouver Martin Servaz »
Bernard Christin, Ici Roussillon
« Servi par les chapitres vifs aux titres empruntés à la littérature, ce nouveau roman noir de Bernard Minier jongle avec le suspense d’un scénario diablement astucieux à la chute imprévisible. »
Frédérique Bréhaut, Le Maine Libre
« Bernard Minier a le chic pour donner vie à des personnages attachants, on le verra encore ici, dans ce roman passionnant »
Bernard Cattanéo, Le Courrier de Gironde
« De rebondissement en rebondissement le romancier nous entraîne à nouveau dans l’un de ses polars dont il a le secret et qui vous font passer de délicieuses et palpitantes nuits blanches. »
Robert Pénavayre, Classic Toulouse
« Un roman miroir où l’auteur interroge la place du mal dans notre époque mais aussi celle de la vérité, de la justice et du regard. Un texte fort habité par un auteur engagé. »
Dig Radio
« Un thriller dense, noir et magistralement construit comme lui seul sait les tisser »
Le Mensuel
« C’est un livre qu’on ne peut pas lâcher (…) Une intrigue invraisemblable, carabinée, démente »
Philippe Manœuvre, Radio Manœuvre
« Une intrigue captivante. »
Nicolas Pipyn, Bonsoir le Prime
« La tension monte mêlant recherche et suspense dans un contexte où tout peut basculer »
Courants d’air pro
« Avec ce nouveau thriller, Bernard Minier livre son œuvre la plus sombre, audacieuse et dérangeante à ce jour. »
Coralie Ledoux, Le Phare de Ré
« Bernard Minier montre une fois encore qu’il est incontestablement un grand maître du thriller (…) Un thriller formidablement haletant »
Serge Bressan, We Culte