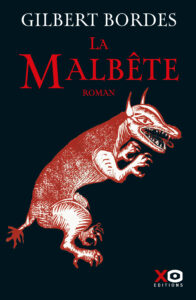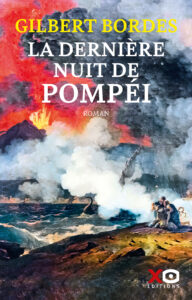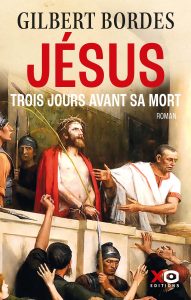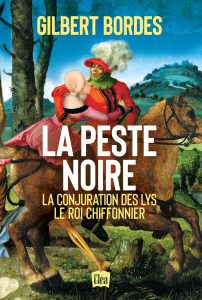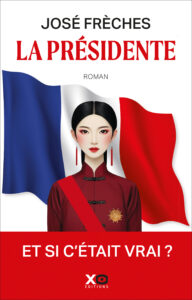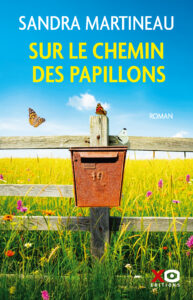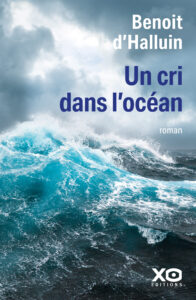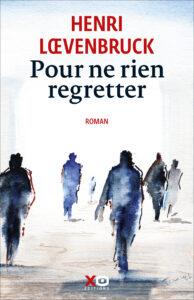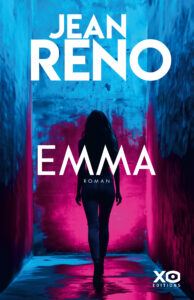Paul, le luthier de votre roman, est-il en quelque sorte votre double de papier? Comme lui, travaillez-vous en écoutant vibrer le bois et les arbres pour les choisir ?
Paul, c’est moi. Avec ses contradictions, ses colères, ses envolées lyriques, sa grande gueule, son désordre d’où naissent souvent les bonnes idées, sa recherche constante du détail qui va faire la différence, son côté brouillon, une sensibilité si lourde qu’elle l’écrase. Tout ceci doit se retrouver dans l’instrument terminé: il est le reflet de celui qui l’a construit, exactement comme un roman; il doit avoir du coffre tout en restant capable de nuances, mais rien n’est jamais gagné d’avance, car en lutherie, un plus un font rarement deux et les mêmes causes n’ont pas toujours les mêmes effets.
Écouter le bois, le regarder pendant des heures, le caresser, chercher à cerner son âme et ses secrets, assembler deux essences si différentes que le sycomore et l’épicéa ne s’explique pas, ça se sent. Construire un instrument, c’est communiquer avec le bois, et cela commence dans la forêt, là où l’arbre a grandi, les racines bien ancrées dans la terre et la cime dans les étoiles; retrouver au fond de soi cette vibration de l’univers que seule la musique peut exprimer… C’est aussi et avant tout une école d’humilité qu’il est bien difficile de raconter sans redondance.
Angline, jeune femme abîmée, entre dans la vie de Paul, lui-même très déprimé. Pouvez-vous nous présenter vos deux personnages ? Comment, de cette rencontre, le goût de la vie va renaître chez l’un et chez l’autre ?
Paul est un homme cassé. Or, construire de bons instruments demande la chaleur intérieure d’un acte d’amour sans le moindre nuage. Le violon ou le violoncelle ne sont que le reflet de l’âme de leur constructeur. Pour cette raison, deux instruments ne sont jamais les mêmes et certains sont mieux réussis que d’autres, même si, pour qui a l’oreille musicale, la patte du luthier reste toujours évidente. Ainsi, parce qu’il est plein de haine, de ressentiments, Paul ne réussit plus à fabriquer de bons instruments. D’ailleurs, cela ne l’intéresse plus. Ses pensées sont ailleurs.
Angline, après son accident à la main, ne peut plus jouer au niveau qui était le sien, celui d’une jeune violoncelliste virtuose qui prépare le concours Rostropovitch. Privée de ce qui a conditionné sa vie depuis son enfance, elle ne se reconnaît plus, elle se contente d’un petit boulot, et fait des bêtises. La rencontre avec Paul va lui montrer l’univers du bois qui précède celui de la musique et va la réconcilier avec elle-même, car avec la lutherie, on ne peut pas tricher. Chaque geste, chaque coup de rabot a un sens et puise sa justesse dans le don de soi du luthier. Humilité et sincérité sont les deux maîtres mots.
L’univers que vous décrivez est à contre-courant de notre époque : un travail lent, patient, dur aussi, qui va séduire progressivement Angline et la réconcilier avec la musique. Dans notre monde de l’immédiateté, de l’image, de l’individualisme à outrance, est-ce un rappel de valeurs oubliées ?
Tout ce qui est facile n’apporte qu’une satisfaction superficielle, souvent mêlée d’un peu d’amertume. Le luthier ne peut pas s’imposer une cadence de production. Parfois tout va très vite, et certains jours, il perd beaucoup de temps parce qu’il n’a pas les bons gestes, la bonne motivation, parce que son esprit est ailleurs. Notre monde ne donne de l’importance qu’à ce qui est facile, ce qui ne demande pas trop de temps. On est sensible à la beauté superficielle des instruments, et cela les grandes usines à violons chinoises l’ont bien compris: elles proposent des instruments fort beaux, très bien finis, mais avec lesquels il ne faut pas espérer jouer de la véritable musique. Ceci fait beaucoup de tort aux artisans.
Tout travail d’art ne peut être sans un don de soi, avec ses qualités, ses défauts, bref, ce qui fait que nous sommes des êtres humains aussi imparfaits que nos violons, mais, malgré tout, capables de mêler la sensibilité de celui qui les a construits à celle du musicien qui les joue.
Il y a un vrai respect de la nature dans votre roman, la recherche de l’arbre parfait en forêt, sa sonorité… Ce roman s’inscrit-il dans la lignée de l’école de Brive dont vous êtes une des grandes figures ?
J’ai toujours été fasciné par les arbres et leur silence tellement fort et particulier que leur présence a quelque chose de protecteur. Ils me parlent : ils me racontent des histoires très anciennes, leur présence m’apaise. Probablement ce livre est-il dans la lignée de l’école de Brive. En tout cas, c’est un des plus personnels – peut-être le plus abouti. Son message : tout est lié dans l’univers, de la plus lointaine galaxie aux arbres centenaires du Jura et aux pensées les plus intimes des hommes et du luthier qui se veut l’intermédiaire entre la musique du monde et ce que l’âme humaine peut en comprendre.
Livres, documentaires, comment expliquez-vous la fascination récente des Français pour les arbres ?
Les arbres sont les grands frères des hommes, leurs gardiens. S’ils meurent, notre agonie est proche. Le contact avec un arbre, l’étreindre comme le font les personnages de mon roman, nous unit à l’univers et donne ce sentiment apaisant que notre vie a un sens.
Au quotidien, comment conciliez-vous deux passions aussi fortes et prenantes que l’écriture et la lutherie ? Voyez-vous des correspondances entre ces deux univers ?
Les deux se ressemblent beaucoup. Ce sont deux façons proches d’aller vers les autres. L’écriture est l’expression de soi par des mots souvent ordinaires, mais qui lustrés par les intentions de l’auteur deviennent uniques; la lutherie traduit sa personnalité par des gestes d’apparence usuelle, mais devenus originaux par l’intention de l’artisan. Écriture et lutherie ne peuvent être que généreuses. J’écris le matin très tôt, et je passe l’après-midi dans mon atelier.
Après les forêts et les arbres, dans quel espace se situera votre prochain livre ?
Il sera très proche. La nature dans sa démesure, sa brutalité, mais aussi sa générosité. L’homme hors sol tout à coup plongé dans cet univers d’où il vient et qu’il ne reconnaît plus.